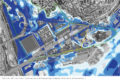This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

par Richard Scoffier, le 19 mars 2018
Josep Lluis Mateo nous reçoit dans son agence, au pied des montagnes qui au nord, délimitent Barcelone. Rédacteur en chef de la revue Quaderns de 1981 à 1990, Professeur à l’ETH de Zurich depuis 2002. C’est aussi l’auteur d’une architecture guidée par des choix structurels audacieux. Une démarche proche de l’abstraction, mais qui sait cependant rester sensuelle et concrète en allant parfois jusqu’aux frontières de la figuration …
D’A : Comment définirez-vous l’architecture ?
Pour Le Corbusier c’est l’art des volumes sous la lumière, moi je préfèrerais la définition plus abstraite du critique suisse Martin Steinmann qui disait que l’architecture c’était de la pensée exprimée en cm2. Une pensée condamnée à s’affirmer, non à travers des mots, mais en termes de surfaces, en restant attentive au moindre cm2…
Cette définition permet d’associer quelque chose d’abstrait et de noble – la pensée – avec de l’utilitaire, du prosaïque… Une vision finalement assez pragmatique qui reste plus proche de mes préoccupations que celle très poétique et plastique du maître moderne. On commence par la pensée, mais cette pensée bifurque et ne peut se déployer, ne peut trouver son amplitude que dans l’étendue, dans la surface, dans la matière… Ce jeu dialectique entre pensée et surface, pensée et matière est sans doute ce qui correspond le mieux à mon activité quotidienne de praticien.
D’A : Mais qu’est-ce que cette matière à travers laquelle la pensée devrait s’exprimer ?
A côté du monde la pure abstraction, des idées, des concepts, des mots, il y a le monde de la présence physique des choses… Le monde des idées n’a pas d’épaisseur, c’est un monde fantomatique qui a besoin de la matière pour s’incarner.
La présence physique des choses, on l’appréhende par les sens – notamment par la vue, par le toucher – mais surtout par un engagement total dans le monde. Parler de la matière, c’est parler des matériaux, de leur texture, de leur couleur ; c’est parler de leur mise en œuvre et des différentes possibilités les articuler entre eux. Et c’est aussi parler de dimensionnements, de rapport au corps, d’ouverture et de fermeture, d’ombre et de lumière…
Construire, faire tenir deux briques ensemble, c’est toujours quelque chose de profondément archaïque. Et j’appartiens à une culture pour laquelle il reste essentiel de maîtriser presque tous les aspects techniques de la construction pour s’en sentir responsable jusque dans les moindres détails. Je sais qu’en France vous êtes plus distant…
D’A : À une époque vous vous êtes intéressé aux 4 éléments de la philosophie présocratique.
Oui, tout à fait. Vous faites allusion à cette publication de l’ETH Zurich, Earth, Air, Water and Fire : The Four Elements and Architecture datant 2014. Elle rejoint effectivement cette réflexion sur la matière que je viens de vous exposer.
Pour les anciens grecs, la nature elle-même est avant tout constituée de ces quatre éléments fondamentaux qui, en se combinant, parviennent à produire toute la richesse du monde. Un discours originaire qui peut encore trouver un écho aujourd’hui : parce qu’il permet d’emblée d’aborder le monde – le contexte général de toute architecture – comme un projet, comme une construction.
Mais pour moi l’architecture est avant tout un outil de connaissance. Elle offre la possibilité de comprendre le monde, c’est une porte d’entrée dans le monde.
Nous parlions de définition au début mais il a y encore d’autres définitions. Notamment celle d’un architecte américain, qui affirmait que, sans l’architecture, le monde serait rigoureusement inintelligible.
L’architecture c’est ce qui permet de comprendre le monde – au-delà de tout ce qui le conditionne – comme une construction. C’est pour cela aussi que je me suis engagé dès le début de ma carrière dans les revues, dans l’édition, dans l’enseignement…
D’A : Mais comment dans les faits cette théorie vous permet-elle de construire ?
Oui, elle me permet de projeter mes bâtiments en comprenant que leur contexte n’est pas simplement une accumulation de données, mais déjà un projet. Le contexte est une construction originelle dans laquelle peuvent venir s’établir d’autres constructions…
Ainsi pour la cinémathèque de Barcelone qui s’inscrit dans la partie populaire de la vielle ville. J’ai vu les immeubles existants de la place et du quartier comme des constructions dressées, tendues, sur leurs murs mitoyens. La structure de l’édifice découle de ce constat : pas de piliers, pas de colonnes, juste deux grands murs en béton brut…
Tout était déjà empreint d’une certaine énergie, ce qui m’a presque naturellement poussé à faire quelque chose de très radical. À cette époque aussi je voulais faire des bâtiments dont la peau serait le squelette et le squelette serait la peau. La Factory à Boulogne-Billancourt, que j’ai réalisé en même temps, témoigne de cette préoccupation.
J’ai toujours eu des problèmes avec les façades, composer, mettre des fenêtres, des portes, ce qui m’a poussé à concevoir les élévations comme des radiographies ou des coupes. Maintenant, comme pour les logements que je viens de terminer à Toulouse, il m’arrive de voir les choses différemment et de penser la peau de manière indépendante, comme ce qui vient envelopper le squelette. Sans craindre d’affirmer une certaine tension entre ces deux éléments.
D’A : Pourquoi cette évolution ?
Peut-être parce que je suis moins dogmatique, je pensais à l’époque que l’enveloppe du bâtiment devait être l’expression de son âme, comme le visage dans la philosophie aristotélicienne.
À Toulouse, au contraire, j’ai cherché à séparer le monde extérieur, du monde intérieur pour donner aux espaces privés un maximum d’intimité. Une dimension domestique que recherche souvent l’architecture vernaculaire dans la forme de ses portes et de ses fenêtres qu’auparavant je ne parvenais pas à dessiner…
D’A : Vos constructions sont parfois presque zoomorphiques, comme si vous vouliez leur insuffler une vie propre…
C’est vrai mais ce n’est pas quelque chose de forcément prémédité.
A l’origine du projet de la cinémathèque, la façade n’était qu’un mur brutal et structurel traversé par des câbles de précontraintes et peu à peu je l’ai vue comme un chien. D’ailleurs, je l’ai appelé « le chien » : un corps monté sur des pattes avec d’un côté la tête en porte-à-faux et de l’autre la queue, comme pour la contrebalancer. Mais ce chien, je ne l’ai pas voulu. Il est apparu subrepticement dans la conception et s’est imposé, je m’en suis rendu compte un jour et je n’ai pas chercher à l’effacer, au contraire je l’ai apprivoisé, j’ai fait avec…
Par contre, à Toulouse, j’ai sciemment voulu que mes trois constructions qui bornent la parcelle puissent apparaître comme les personnages d’une comédie figée… Des personnages habillés, à l’image des arlequins de la Comedia de l’Arte, de briques alternativement blanches et noires. L’un des trois est très sombre, un autre très clair pour composer un ensemble dynamique, une unité en déséquilibre…
D’A : Vous semblez quand même très attaché aux références extra-architecturales.
Oui, notamment à la nature… Les arbres, les animaux, ce sont des choses dont on n’a pas à discuter et qui s’imposent. Elles sont là, comme nous. Elles ont le même droit à la présence…
Bien sûr je connais l’histoire de l’architecture et la production architecturale contemporaine, mais ce n’est pas la même chose. Je les connais mais je n’essaie pas de les reproduire, c’est une question de protection. Nous devons tout connaitre, mais nous devons aussi tout oublier…
Comme s’il fallait à chaque projet tout recommencer à zéro ! Bien que ce soit un mythe… En tout cas, l’expérience doit rester en infrastructure. On doit être confronté sans protection à ces forces – sociales, telluriques ou climatiques – qui modèlent nos villes et notre territoire.
D’A : Vous êtes actuellement responsable du « Grand Central » le pôle multimodal de Nice et de son quartier d’affaire. Comment voyez-vous les relations entre architecture et urbanisme ?
Bien sûr il y a des relations, mais ce n’est absolument pas la même chose. L’urbaniste fait le lien entre : d’un côté, des potentialités économiques et sociales, un cadre juridique et une volonté politique de faire des choses ; de l’autre, des architectes qui vont réaliser ces choses. Il est là pour fixer les règles du jeu et parfois pour arbitrer, mais il ne joue pas et ne participe pas à l’action.
Après l’école italienne notamment après Aldo Rossi, on a pensé que l’on pouvait dessiner des villes entières, que l’on pouvait faire de l’architecture avec des plans d’urbanisme. Or, il n’en est rien ! Le rôle de l’urbaniste ce n’est pas de tout dessiner, c’est de permettre l’éclosion de bonnes architectures. Je sais bien « bonne architecture » ça ne veut pas dire grand-chose, mais même si cette définition est bancale, elle me convient néanmoins. La bonne architecture c’est le ferment indispensable de la qualité urbaine, réalité physique est donnée à la fin à travers l’architecture.
L’urbanisme doit créer les conditions pour que la bonne architecture soit simplement possible. Il doit négocier avec cette constellation de forces – économiques, politiques…- qui régente aveuglément le cadre bâti pour protéger l’architecte qui, sans lui, serait balayé par elle.
Permettez-moi d’insister encore sur la différence de ces métiers, l’un est plus technocratique mais profondément animé par une mission d’intérêt général : préserver une unité, sans laquelle ce serait le retour du chaos. L’autre doit permettre l’incubation de la ville de demain.
Mais sans bonne architecture, il n’y a aucun bon projet d’urbanisme…
Ce qui est compliqué aussi, c’est la temporalité de l’urbanisme. Je suis à Nice depuis bientôt huit ans et ça commence tout juste à sortir, c’est un peu frustrant. En architecture nous avons un rapport au temps déjà distendu – on conçoit des projets qui se réalisent des années après – mais en urbanisme ça se distend encore et encore. Quand je pense à mes amis artistes ou graphistes qui sont capables de finaliser un projet en quelques jours ou même en quelques heures !
D’A : Comment définiriez-vous l’urbanisme d’aujourd’hui ?
Il y a d’abord eu les urbanistes très attentifs à la dimension économique de l’espace ; puis les architectes plus portés sur les morphologies ; enfin arrivent maintenant les paysagistes ; peut-être plus sensibles au devenir écologique des territoires habités. Je ne suis pas très engagé dans la morphologie de l’îlot, qu’il soit ouvert ou fermé, je ne pense pas que cela soit vraiment important. Par contre je suis très intéressé par l’apparition des paysagistes sur la scène de l’aménagement du territoire. Je pense qu’ils sont symptomatiques de la péremption de la ville minérale du dix-neuvième siècle, du Paris d’Haussmann comme de la Barcelone de de Cerdà… Ces modèles de ville ordonnancée et régulière tendent à disparaitre au profit d’un urbanisme plus territorial. On passe d’une organisation totalement artificielle à des aménagements qui ont plus à voir avec le géographique : la nature des sols, la faune et la flore…
Les paysagistes établissent des lignes de force, augmentent ou affaiblissent ce qui existe sans chercher à formaliser.
D’A : De quels praticiens vous sentez-vous proche ?
Il a beaucoup d’architectes qui m’intéressent. Mais l’architecte vivant qui me fascine le plus, parce qu‘il est parvenu à travailler dans la durée et à se détacher de toute question d’ordre stylistique, c’est Renzo Piano. Il a su depuis de longues années maintenir une production de très haute qualité, que ce soit pour des projets à grande échelle, des logements, des équipements ou même de petites constructions. Vieillir, mais sans devenir une caricature de lui-même comme c’est souvent le cas.
Il me rend optimiste parce qu’il me prouve qu’il n’y a pas de fatalité et qu’il reste possible même lorsque l’on commence à devenir âgé, de continuer à innover, à défricher de nouvelles terres et à ouvrir de nouvelles perspectives pour ceux qui viennent après.
D’A : Comment voyez-vous l’avenir de l’architecture ?
Je ne suis pas pessimiste. Je voyage un peu partout en Europe et je me rends compte que, quoi que l’on puisse en dire, notre savoir reste nécessaire, alors qu’il y a beaucoup de métiers qui ne le sont pas ou plus… Bien sûr, la profession est en crise et va sans doute se modifier, partout ce savoir de l’espace et de la matière est requis pour synthétiser, pour donner des réponses à des volontés politiques, à des situations sociales critiques… La société a besoin de l’architecte pour se projeter vers l’avenir.
Entretien publié dans le magazine D’Architecture numéro 265, p. 22 – 27. Septembre 2018, France.